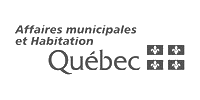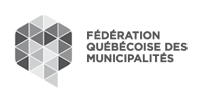Quoi! Le camp de jour municipal est une activité à risque!
Jeudi, 15 juin 2017Par Me Sylvain Déry, LL.B, M.B.A., Adm.A, OMA
Le rôle des présomptions de responsabilité dans le contexte des camps de jour municipaux
INTRODUCTION
La vie en société nous impose certaines contraintes que nous nous devons de respecter sans quoi les droits de tous et chacun risqueraient d’être mis en péril.
L’obligation de sécurité est l’une de ces contraintes.
Elle s’applique, en effet, à toutes les sphères de la vie courante afin de donner à chacun l’assurance qu’aucun préjudice ne lui sera causé. La contravention à cette obligation entraîne des sanctions, notamment sur le plan de la responsabilité civile.
L’article 1457 du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q.) sert de base au régime de responsabilité civile extracontractuelle.
Toute personne pourra donc invoquer cet article afin de demander la réparation d’un préjudice qui lui a été causé.
Ainsi, non seulement une personne doit réparer le dommage causé par sa faute mais, dans certains cas, elle pourra aussi être tenue de réparer celui causé par une autre personne ou par un bien qu’elle a sous garde.
C’est ici que l’obligation de sécurité entre en ligne de compte.
En effet, chacun s’y trouve soumis en raison du fait qu’il ou elle vit en société. Cette obligation implique qu’un individu, en plus de porter une attention particulière à sa personne et à ses biens, doit aussi porter attention à la personne et aux biens d’autrui. Cela se traduit dans les faits par l'obligation d'agir de façon prudente et diligente afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux biens ou à la personne d’autrui.
On a souvent qualifié cette obligation d’implicite dans le domaine contractuel. En effet, la jurisprudence a eu tendance à considérer que l’obligation de sécurité faisait partie intégrante du contrat sans que les parties aient besoin de l’y inclure explicitement.
Voyons maintenant comment se traduit cette obligation pour les camps de jour municipaux au regard des différentes présomptions prévues au Code civil du Québec. Rappelons que la "présomption" permet de tirer de faits connus l’inférence d’un fait inconnu. Les présomptions facilitent ainsi la preuve des victimes dans le cadre des procédures judiciaires.
La première partie est consacrée aux présomptions pertinentes. La seconde partie traite des moyens d'exonération de la responsabilité, le cas échéant.
PARTIE 1 - LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité du titulaire de l’autorité parentale
Évidemment, les titulaires de l’autorité parentale ne sont pas nécessairement les parents au sens biologique du terme. En effet, il peut arriver que ceux-ci en aient été déchus ou qu’ils y aient renoncé. Dans ce cas, c’est le tribunal qui a le pouvoir de nommer un nouveau tuteur à l’enfant.
L’article 1459 du C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard des titulaires de l’autorité parentale. En effet, cet article mentionne qu’ils sont obligés de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard duquel ils exercent cette autorité. Cette responsabilité des titulaires de l’autorité parentale est basée sur leur manquement présumé à une des obligations rattachées à ce "titre".
Ainsi, on présume que lorsqu’un enfant cause un préjudice à autrui, c’est parce que ses tuteurs ont eux-mêmes commis une faute dans son éducation.
Ceci dit, l’application de l’article 1459 C.c.Q. n’est pas automatique. Le demandeur a d’abord le fardeau d’établir :
- la faute ou le fait fautif;
- le dommage; et
- le lien entre ce dommage et la faute ou le fait fautif.
Il faut aussi prouver que l’auteur du geste est bien mineur et que la personne dont la responsabilité est recherchée est bien la détentrice de l’autorité parentale.
Une fois que tous ces éléments sont mis en place, la présomption peut dès lors être invoquée.
L’article 1459 C.c.Q. doit être lu en relation avec l’article 1462 C.c.Q. en ce qui concerne la notion de fait fautif. Le fait fautif est celui qui, s’il avait été posé par une personne douée de raison, aurait été considéré comme fautif.
La responsabilité résultant d’une délégation de l’autorité parentale
Au Québec, conformément à l'article 1460 C.c.Q., lorsque les parents ou les titulaires de l’autorité confient la garde, la surveillance ou l’éducation de leurs enfants mineurs à une autre personne, il s’opère, par ce simple geste de la vie courante, une délégation de l’autorité parentale.
C’est d’ailleurs le cas lorsqu’un parent confie son enfant à un camp de jour municipal.
C’est donc le gardien qui se trouve investi de cette autorité pendant la période de temps où il a le mineur sous sa garde. Il en résulte que si un mineur cause un préjudice à une autre personne, la responsabilité de son gardien pourra être retenue.
Pour que la présomption puisse trouver application, il faudra prouver la faute ou le fait fautif du mineur, le préjudice ainsi que le lien de causalité. Il faudra bien entendu établir qu’il y a effectivement eu délégation de l’autorité parentale.
La responsabilité du commettant (la municipalité)
Le législateur québécois énonce une autre présomption à l’article 1463 C.c.Q. Il prévoit en effet que le commettant, c’est-à-dire l’employeur (donc la municipalité), pourra être tenu responsable de la faute commise pas son préposé (employé), c’est-à-dire une personne sur laquelle il exerce un contrôle. Le moniteur, embauché par la municipalité, est un préposé au sens de l'article 1463 C.c.Q.
La personne qui voudra invoquer cet article aura d’abord le fardeau de prouver cinq choses :
- La faute du préposé;
- L’existence d’un préjudice;
- L’existence d’un lien entre la faute et le préjudice;
- Le lien de subordination entre le commettant et le préposé. La preuve de ce lien peut être faite en démontrant que le commettant a le pouvoir de donner des ordres au préposé. Ainsi, dans le cas d’un camp de jour municipal, le commettant est la municipalité elle-même;
- La preuve que le préposé a agit dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité du fait des biens
À l’article 1465 C.c.Q., le législateur québécois prévoit que le gardien d’un bien doit réparer le préjudice causé à une personne par le fait autonome de ce bien. Il y aura ainsi présomption de faute de la part du gardien si la victime démontre trois choses :
- Le préjudice causé par un bien;
- Le fait que la personne de qui on recherche la responsabilité est bien la gardienne du bien qui a causé le dommage. La garde du bien s’établit en fonction du critère de pouvoir et de contrôle réel du bien. Le gardien du bien n’est donc pas nécessairement le propriétaire du bien ni la personne qui en a la garde physique;
- Le fait autonome du bien, c’est-à-dire que l’accident a eu lieu sans intervention humaine directe.
La responsabilité du propriétaire et de l’usager d’un animal
La présomption de responsabilité prévue à l’article 1466 C.c.Q. revêt une importance particulière dans un contexte de camp de jour en regard de l’obligation de sécurité. En effet, il est possible de retrouver des animaux dans les camps de jour, notamment dans les mini-fermes.
Tout d’abord, l’article 1466 C.c.Q., permet de rechercher la responsabilité de deux personnes, soit celle du propriétaire de l’animal et/ou celle de l’usager.
L’alinéa 1 de l’article 1466 C.c.Q. prévoit que le propriétaire doit réparer le préjudice causé par son animal même si celui-ci est sous la garde d’un tiers et même s’il est égaré ou s’il s’est échappé. L’alinéa 2 du même article prévoit une responsabilité conjointe de l’usager et du propriétaire dans le cas où le préjudice a été causé alors que qu’une autre personne que le propriétaire se servait du bien. Il est aussi important de mentionner que l’article 1466 C.c.Q. ne vise que les animaux sur lesquels il est possible d’exercer un certain contrôle.
Par conséquent, les animaux sauvages n’appartenant à personne ne sont pas visés par cette présomption.
Le fardeau de preuve de la victime est relativement simple :
- Premièrement, elle devra prouver l’existence de son préjudice.
- Deuxièmement, elle devra prouver la propriété de l’animal ou son utilisation par la personne dont elle veut retenir la responsabilité.
La ruine de l’immeuble
L’obligation de sécurité est aussi présente à l’égard des installations qui se trouvent sur le site concerné. En effet, en accueillant des jeunes sur leur propriété, les camps de jour se doivent de leur offrir un environnement sécuritaire, ce qui passe, entre autres, par un entretien adéquat des immeubles.
L’article 1467 C.c.Q. prévoit que le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.
Il ressort de cet article que la présomption qui y est prévue ne s’appliquera uniquement que lorsque la ruine partielle ou totale de l’immeuble résultera d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
Ainsi, il appartient au demandeur de prouver que non seulement c’est l’immeuble du défendeur qui lui a causé un préjudice, mais aussi que cela est dû à un défaut dans l’entretien ou dans la construction de l’immeuble. Il n’est pas nécessaire pour les fins de l’application de cet article que le défaut d’entretien ou le vice de construction soit attribuable au propriétaire de l’immeuble. En résumé la victime aura à prouver cinq choses :
- La qualité d’immeuble du bâtiment qui lui a causé préjudice;
- La qualité de propriétaire du défendeur;
- La ruine de l’immeuble;
- Le fait que cette ruine est le résultat d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien;
- L’existence d’un préjudice.
Si l'un de ces éléments fait défaut, la présomption ne peut pas s’appliquer.
De plus, un recours en vertu de l’article 1467 C.c.Q. n’exclut en rien l’application de l’article 1465 (responsabilité du fait des biens) si les circonstances le permettent. En effet, il n’est pas rare pour un camp jour de cumuler les titres de propriétaire et de gardien.
PARTIE 2 - LES MOYENS D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ
Les moyens d'exonération
Dans les faits, aucun geste ne peut réellement être posé pour empêcher ces présomptions de trouver application. En effet, s'agissant de présomption, la simple preuve des conditions d’ouverture précitées suffira à les mettre en œuvre sans égard aux gestes posés par le camp de jour. C’est à l’étape de l’exonération que les gestes posés pour empêcher le préjudice de se produire deviennent importants.
C’est donc le comportement du camp de jour qui pourra, dans certains cas, faire la différence entre une décision confirmant la responsabilité et une concluant à la non responsabilité.
Il est vrai que les présomptions énumérées précédemment semblent lourdes à première vue. Toutefois, aucune d’elles n’est irréfragable, c’est-à-dire qu’elles peuvent toutes être repoussées par un moyen ou un autre.
Certaines défenses seront toutefois plus restreintes que d’autres et demanderont un cadre d’application bien précis. Il faudra bien entendu qu’il soit établi que la présomption s’applique pour qu’il soit nécessaire de recourir à ces moyens de défense.
L’exonération dans le cas d’une délégation de l’autorité parentale
Comme les parents, le gardien peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute dans :
- La garde;
- La surveillance; ou
- L’éducation du mineur.
L’étendue de l’obligation du gardien dépend directement de la tâche qui lui a été déléguée par les parents. Ainsi, le défendeur doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de cette tâche. Cette démonstration se fait concrètement en deux temps.
- Premièrement, il est primordial de mettre en preuve le contexte général dans lequel le gardien a exercé la tâche qui lui a été dévolue. Concrètement cela implique de démontrer que des consignes claires ont été données à l’enfant, que l’activité à laquelle il participait est adaptée à son âge, que des règlements internes sont en vigueur, qu’il existe des procédures en cas d’accident et surtout que ces procédures ont été respectées. Tout ça dans le but de démontrer que les mesures prises pour accomplir la tâche confiée par les parents sont adéquates.
- Deuxièmement, il faut démontrer l’imprévisibilité de l’acte. Dans le cadre de l’obligation de sécurité des camps de jour, une telle défense se traduit, de façon générale, par la démonstration au juge qu’il n’y a eu aucune faute dans la surveillance de l’enfant et que même si, par exemple, le nombre de surveillants avait été plus élevé, l’accident n’aurait pu être évité.
Les deux parties de la défense sont indissociables, elles doivent toutes deux être présentées au juge sans quoi il est fort peu probable que celui-ci parvienne à conclure à la non responsabilité du camp de jour.
Ce qu’il faut donc retenir de ce qui précède c’est qu’il est important d’avoir des règles internes de sécurité, mais qu’il l’est encore plus de les respecter.
De plus, il ressort de la jurisprudence que le degré de surveillance requis par le gardien varie en fonction du degré de dangerosité de l’activité.
Plus l’activité est dangereuse, plus il faut que le gardien exerce une surveillance étroite.
Les juges rappellent que le gardien d’un enfant mineur est confronté à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il n’a pas à garantir que rien n’arrivera à l’enfant pendant qu’il est sous sa garde. En revanche, il doit prendre tous les moyens raisonnables qui sont à sa disposition pour éviter qu’un préjudice ne soit causé.
On ne demande pas au gardien de prévoir tout ce qui est susceptible de se produire, mais uniquement ce qui est probable.
L'exonération du commettant
Le libellé de l’article 1463 C.c.Q. ne prévoit aucun moyen de défense, comme c’est le cas pour les article 1459 ou 1460 C.c.Q. Le commettant ne peut pas repousser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. Ses seules portes de sorties sont :
- Les cas de force majeure; ou
- La faute de la victime.
La force majeure est prévue à l’article 1470 C.c.Q. Elle consiste en un événement imprévisible et irrésistible. Les meilleurs exemples de forces majeures sont sans aucun doute les catastrophes naturelles. Ainsi, si un tremblement de terre survient pendant que des jeunes sont en randonnée avec un moniteur et que l’un d'eux se blesse, la force majeure pourra être invoquée pour exclure la responsabilité du camp sous 1463 C.c.Q.
En ce qui concerne la faute de la victime, si on réussit à prouver que la victime s’est blessée en raison d’une faute qu’elle a elle-même commise, le commettant pourra être exonéré de toute responsabilité. Évidemment, lorsque la victime est mineure, ce qui est souvent le cas dans les camps de jours, d'autres présomptions pourront s'appliquer, dont celle prévue à l'article 1460 (délégation de l'autorité parentale).
Il est aussi possible de plaider l’inapplicabilité de l’article 1463 C.c.Q. en démontrant qu’une des conditions de mise en œuvre n’est pas respectée, par exemple que l’employé n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions ou encore qu’il n’existait aucun lien de préposition au moment des faits.
Il est a noter qu’advenant le cas d’une condamnation à des dommages et intérêts en vertu de l’article 1463 C.c.Q., l’employeur conserve tous ses recours contre son employé.
L'exonération de la responsabilité du fait des biens
La présomption résultant de l’article 1465 C.c.Q., est une présomption de faute. Le gardien peut donc la repousser en prouvant qu’il n’en a commis aucune. Cette preuve pourra être faite, par exemple, en invoquant qu’aucune faute n’a été commise dans l’entretien du bien et qu’il était utilisé conformément aux règles de l’art. Le gardien peut aussi prouver son absence de faute en démontrant qu’il ne pouvait pas prévenir le préjudice. La faute de la victime et la force majeure sont aussi des défenses disponibles.
L’exonération du propriétaire et du gardien d’un animal
Dans le cas de la responsabilité découlant du fait d’un animal, la défense d’absence de faute n’est pas admise. Le fait d’avoir agit en personne prudent et diligente dans la garde de l’animal n’est d’aucun secours. Ainsi, seule la force majeure et la faute de la victime restent disponibles.
Pour ce qui est de la force majeure, l'on doit constater qu’il sera bien difficile de démontrer qu’un événement imprévisible et irrésistible est à l’origine du dommage causé par l’animal. Cela revient à prouver que c’est la force majeure qui a amené l’animal à causer le dommage.
En revanche, dans certains cas, la faute de la victime sera plus facile à établir. Cependant, l’exonération obtenue avec ce type de défense ne sera pas nécessairement totale ce qui pourra mener à un partage de la responsabilité entre la victime et le propriétaire ou le gardien de l’animal. Par exemple, si le propriétaire réussi à démontrer une provocation de la part de la victime, il pourra y avoir exonération totale ou partielle en fonction des faits de l’espèce.
L’exonération de la responsabilité découlant de la ruine de l’immeuble
Il découle de l’article 1467 C.c.Q., que le propriétaire d’un immeuble a une obligation de résultat.
Cela veut dire que le propriétaire a l’obligation de garantir aux occupants de ces immeubles qu’aucun préjudice ne leur sera causé par les immeubles en question. Par conséquent, une défense basée sur un entretien adéquat du bâtiment n’est pas admissible, pas plus qu’une défense basée sur l’ignorance du vice de construction à l’origine du préjudice.
Dans de telles circonstances, les seules défenses valables sont la force majeure et la faute de la victime.
Une défense de force majeure aurait par ailleurs peu de chance de succès étant donné les normes sévères établies par les différentes lois québécoises en matière de construction et de rénovation des immeubles. En effet, les lois et la jurisprudence exigent qu’un bâtiment résiste à des conditions relativement mauvaises. Par conséquent, la force majeure constitue rarement un moyen de défense efficace.
La preuve d’une faute de la victime s’avère donc être la défense présentant le plus de chance de succès.
Le propriétaire a aussi la possibilité d’éviter carrément l’application de l’article 1467 C.c.Q. en faisant la démonstration qu’il manque une des conditions nécessaires à sa mise en œuvre.
Les clauses d’exonération de responsabilité
L’article 1474 C.c.Q. prévoit qu’en aucun cas une personne ne peut exclure ou même limiter sa responsabilité pour un préjudice matériel causé par une faute lourde ou intentionnelle.
Le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu’il est totalement impossible d’exclure ou de limiter sa responsabilité pour tout préjudice moral ou physique causé à une personne.
Par conséquent, toute clause allant à l’encontre de cela sera illégale et ne sera pas prise en compte et ce même si la personne concernée l’a signée de son plein gré et en toute connaissance de cause.
En outre, il n’est pas possible de s'entendre au préalable à l'effet que la loi ne sera pas respectée! Par exemple, le fait de signer un accord avec les parents d’un moniteur mineur stipulant qu’il est permis à ce dernier de consommer de l’alcool ne suffira pas à écarter la responsabilité du camp de jour dans l’éventualité d’un accident lié à cette consommation.
CONCLUSION
En conclusion, l’examen des présomptions de responsabilité civile dans le cadre des activités d'un camp de jour permet de conclure que le législateur a voulu avant tout protéger la victime en s’assurant qu’elle puisse obtenir réparation.
Les défenses qui peuvent être invoquées reposent souvent sur l’absence de faute.
Le défendeur doit en réalité démontrer qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter qu’un préjudice ne soit causé.
Le défendeur doit démontrer qu'il a respecté ce que lui imposait son obligation de sécurité.
Cependant, l’absence de faute n’est pas toujours une défense disponible, par exemple dans le cas d’un préjudice causé par un animal. C’est pourquoi, dans ce cas, il est très important de redoubler de prudence et de vigilance.
Ainsi, il est recommandé aux municipalités de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les activités proposées dans le cadre de leur camp de jour soient sécuritaires et que les règles soient bien expliquées et surtout... comprises des participants.
Bon été 2017 à tous!
 |
Me Sylvain Déry Bachelier en droit et titulaire d'une Maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Laval, je suis membre du Barreau du Québec et membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A). Je détiens deux diplômes universitaires en droit de l'Université de Montpellier (France). Je siège au sein du Comité consultatif du Barreau du Québec en droit municipal. Je suis par ailleurs Officier municipal agréé (OMA). Courriel : Contacter |
Chroniques
 25 novembre 2023
Ressources humaines
Pratico-Pratique / Obligations légales pour un recrutement sans discrimination
25 novembre 2023
Ressources humaines
Pratico-Pratique / Obligations légales pour un recrutement sans discrimination
Par Catherine Bélanger, conseillère en ressources humaines à la FQM
Pratique
Jurisprudence
| Responsabilité municipale | Belmamoun c. Ville de Brossard, 2023 QCCS 3826 * |
| Aménagement et urbanisme | St-Pierre c. Audet, 2023 QCCS 2610 |
| Aménagement et urbanisme | 7350121 Canada inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 1335 |
| Taxes | Ville de Boisbriand c. Centre communautaire religieux hassidique, 2023 QCCA 1301 |
| Permis | Delage c. Ville de Westmount, 2023 QCCA 1251 |
Dernières nouvelles
Revue de presse
- MRC Nouvelle-Beauce: le nouveau centre administratif coûtera plus cher
- Sherbrooke obtient 1,3 M$ de plus pour aider les PME
- Plus de 5 millions$ d'investissements à Saint-Ferdinand
- Nouveau report d'élections au Québec
- Zoo Sauvage et Village historique de Val-Jalbert : On se prépare à ouvrir. mais à quel prix?
À lire aussi
Derniers commentaires
-
Nous lui offrons toutes nos félicitations à continuer de représenter n...
Lundi 27 novembre 2023, à 14 h 43 -
Tellement valorisant pour nos jeunes animateurs!
BRAVO👏
Vendredi 24 novembre 2023, à 13 h 30 -
Super madame Vigneault, la MRC de l'Érable a accompagné la Municipalit...
Mardi 31 octobre 2023, à 7 h 54