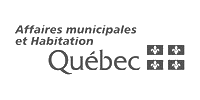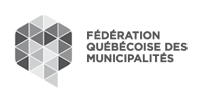Depuis maintenant quelques années, les municipalités ont accès à un nouvel outil afin de générer des revenus supplémentaires qu’elles peuvent obtenir auprès de divers promoteurs immobiliers. Cependant, la mise en place de cet outil nécessite de bien élaborer un règlement à cet effet.
 20 avril 2021
Relations du travail
Santé et sécurité au travail et projet de loi 59 : Où en sommes-nous?
20 avril 2021
Relations du travail
Santé et sécurité au travail et projet de loi 59 : Où en sommes-nous?
Par Me Geneviève Perron, avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités
 19 avril 2021
Administration et finance
La redevance au développement : un outil pour financer vos projets de développement urbain
19 avril 2021
Administration et finance
La redevance au développement : un outil pour financer vos projets de développement urbain
Par Me Yanick Tanguay, avocat en droit municipal au sein du cabinet Dunton Rainville
 12 avril 2021
Travaux publics et voirie
Quand l'écoulement du temps ne peut légaliser l'écoulement de l'eau...
12 avril 2021
Travaux publics et voirie
Quand l'écoulement du temps ne peut légaliser l'écoulement de l'eau...
Par Me Chloée Fauchon, avocate au sein du cabinet Lavery Avocats
Une municipalité qui souhaite créer ou aménager (y compris canaliser) un cours d’eau devrait d’abord s’assurer d’obtenir, en plus de celle du ministre de l’Environnement[1], l’autorisation de la MRC[2]. Et lorsque cet écoulement d’eau est dévié sur une propriété privée, la MRC doit, au surplus, acquérir la servitude ou le droit de propriété requis des propriétaires privés, que ce soit de gré à gré ou par voie d’expropriation.
 6 avril 2021
Aménagement et urbanisme
Un usage commercial effectué en catimini peut-il être générateur de droits acquis?
6 avril 2021
Aménagement et urbanisme
Un usage commercial effectué en catimini peut-il être générateur de droits acquis?
Par Me Rino Soucy, avocat en droit municipal, en droit de l'environnement, en droit immobilier et en droit civil chez DHC Avocats
Introduction
Les municipalités doivent souvent se défendre à l’encontre d’un argument de droits acquis pour faire respecter leur règlement de zonage. Dans l’arrêt de principe régulièrement cité par les tribunaux en cette matière, soit l’affaire Huot c. Municipalité de l’Ange-Gardien[1], on retient ce qui suit :
« Les principales conditions d’existence des droits acquis sont bien connues, maintes fois exposées en doctrine et en jurisprudence :
a) Les droits acquis n’existent que lorsque l’usage dérogatoire antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions prohibant un tel usage était légal.
b) L’usage existait en réalité puisque la seule intention du propriétaire ou de l’usager ne suffit pas.
c) Le même usage existe toujours ayant été continué sans interruption significative.
d) Les droits acquis avantagent l’immeuble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas personnels, mais cessibles, suivant l’immeuble dont ils sont l’accessoire.
e) Ils ne peuvent être modifiés quant à leur nature et parfois quant à leur étendue bien que les activités dérogatoires peuvent être intensifiées en certains cas.
f) La seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis. »
 6 avril 2021
Relations du travail
Éviter les embrouilles : comment rédiger un contrat de travail juste pour les parties
6 avril 2021
Relations du travail
Éviter les embrouilles : comment rédiger un contrat de travail juste pour les parties
Par Me Héloïse Desgagnés, avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités
 31 mars 2021
Assurances
Étude de cas : Marcel et les disjoncteurs
31 mars 2021
Assurances
Étude de cas : Marcel et les disjoncteurs
Par Me Antoine Pleau-Trottier, superviseur | Service de la gestion des risques
 29 mars 2021
Environnement / Développement durable
L'eau potable : une ressource à protéger!
29 mars 2021
Environnement / Développement durable
L'eau potable : une ressource à protéger!
Par Me Matthieu Tourangeau, avocat au sein du cabinet Morency Société d'avocats
 29 mars 2021
Sécurité publique et civile
COVID-19 : les tribunaux se prononcent sur certaines mesures sanitaires
29 mars 2021
Sécurité publique et civile
COVID-19 : les tribunaux se prononcent sur certaines mesures sanitaires
Par Annick Poulin, conseillère juridique à SOQUIJ
 23 mars 2021
Éthique et gouvernance
La conformité du processus réglementaire
23 mars 2021
Éthique et gouvernance
La conformité du processus réglementaire
Par Vicky Lizotte, vice-présidente à la vérification / Commission municipale du Québec
 22 mars 2021
Responsabilité municipale
La prescription en matière municipale
22 mars 2021
Responsabilité municipale
La prescription en matière municipale
Par Me Marie-Claire Côté, avocate au sein du cabinet Dunton Rainville - Avocats et notaires
La question de la prescription est certainement l’un des premiers aspects à vérifier dans un dossier litigieux, puisqu’ayant une incidence sérieuse sur les droits que pourraient faire valoir les parties. Prévue dans le Code civil du Québec, la prescription est ce qui permet d’acquérir un droit ou de le voir s’éteindre par le seul écoulement du temps. Elle est d’une durée variable selon le domaine de droit, par exemple d’un an en matière de diffamation, de trois ans en responsabilité civile, de 10 ans pour un immeuble.
Filtrer les résultats
Derniers commentaires
-
Nous lui offrons toutes nos félicitations à continuer de représenter n...
Lundi 27 novembre 2023, à 14 h 43 -
Tellement valorisant pour nos jeunes animateurs!
BRAVO👏
Vendredi 24 novembre 2023, à 13 h 30 -
Super madame Vigneault, la MRC de l'Érable a accompagné la Municipalit...
Mardi 31 octobre 2023, à 7 h 54
Dernières nouvelles
Revue de presse
- MRC Nouvelle-Beauce: le nouveau centre administratif coûtera plus cher
- Sherbrooke obtient 1,3 M$ de plus pour aider les PME
- Plus de 5 millions$ d'investissements à Saint-Ferdinand
- Nouveau report d'élections au Québec
- Zoo Sauvage et Village historique de Val-Jalbert : On se prépare à ouvrir. mais à quel prix?